L’histoire du
LATÉ 28
La voilure haute était du type monoplan rectiligne à bouts arrondis, elle était formée de nervures en bois (spruce), raidie par deux longerons en aluminium.

Caractéristiques techniques
Dimensions
• Envergure : 19,25 m
• Longueur : 13,64 m
• Hauteur : 3,58 m
• Surface alaire : 48,60 m²
Masse
• Masse à vide : 3 215 Kg
• Masse maximum : 3 856 Kg
Performances
• Vitesse de croisière : 215 Km/h
• Vitesse maximale : 223 Km/h
• Plafond : 5 200 m
• Distance franchissable : 4 685 Km

Capacité
• Nombre de places : 8 passagers
• Équipage : 2 membres
Il se révèla brillant face à la concurrence, il remporta 16 records du monde.
Outre ses excellentes qualités de vol, il était fiable, robuste et surtout offrait un grand confort aux huits passagers, en faisant évoluer les standards de l’époque
La voilure haute était du type monoplan rectiligne à bouts arrondis, elle était formée de nervures en bois (spruce), raidie par deux longerons en aluminium.
Les versions du LATÉ-28
Les LATÉ-28 furent déclinés en 8 versions selon la motorisation et l’usage (avion terrestre – hydravion – avion de records).
Deux prototypes LATÉ-28 (version terrestre) furent construits, chacun avec un moteur différent. Il s’agissait du LATÉ 28.0, avec un moteur Renault 12Jb de 373 kW (500 ch) et du LATÉ-28.1 avec un moteur Hispano-Suiza 12 Hbr de 500 ch plus puissant. Ce dernier rendait de meilleures performances notamment en vitesse ascensionnelle et horizontale, d’où son utilisation pour le survol des Andes.

LES PREMIERS VOLS ET ESSAIS
Durant la période du mois de mars au mois de mai 1929, le pilote d’essais de la Compagnie Générale Aéropostale (CGA) Élisée Négrin effectua le premier vol du LATÉ-28.1.
A la vue des bons résultats des essais, rapidement (août 1929) les Services Techniques de l’Aéronautique (STA) délivrèrent le certificat de navigabilité pour le Transport Public avec Passagers (TPP) au LATÉ28.
L’usine de Montaudran avait lancé la production de série des LATÉ-28 avant que le prototype LATÉ-28.1 n’eut reçu son Certificat de Navigabilité (CDN).
Le premier vol promotionnel Paris-Madrid le 24 septembre 1929 fut effectué avec un
LATÉ-28.1, soit 1200 Km en 05h11mn, aux commandes Elisée Négrin et Adrian Bédrignans.
L’exploitation des LatÉ-28
Dès le premier mois de 1930, 14 LATÉ-28.0 furent affectés sur les lignes de l’Espagne et de l’Afrique alors que la plupart des 13 LATÉ-28.1 rejoignaient les lignes de l’Amérique du Sud.
La Traversée de l’Atlantique Sud
C’est avec la version 28.3, hydravion, immatriculée F-AJNQ, produite en un seul exemplaire et titulaire de différents records, que l’équipage composé de Jean Mermoz, pilote, Jean Dabry, navigateur et Léopold Gimié, radio, réussit la première traversée commerciale de l’Atlantique Sud, le 12 mai 1930.
Embarquant 130 kilos de courrier, dont son propre certificat d’homologation, les 3 hommes survolèrent les 3200 km de distance, séparant Saint-Louis-du-Sénégal à Natal, au Brésil, en 21 heures et 30 minutes.
Mais le vol retour vers l’Afrique se fit dans la douleur après le remplacement des flotteurs, puisqu’entre le 3 juin et le 8 juillet Mermoz fit 53 tentatives d’envol avant de réussir à arracher l’avion aux flots, alors que des ordres arrivaient tout juste de France, demandant d’embarquer l’avion sur un bateau.
Mais certainement fatigué par tant d’essais, l’appareil fut perdu durant ce même vol, et son équipage sauvé par le navire aviso le Phocée, après un amerrissage dans l’Atlantique, le moteur ayant surchauffé et perdu toute son huile.
L’Héritage du LATÉ-28
Les LATÉ-28 furent déclinés en 8 versions selon la motorisation et l’usage (avion terrestre – hydravion – avion de records).
Deux prototypes LATÉ-28 (version terrestre) furent construits, chacun avec un moteur différent. Il s’agissait du LATÉ 28.0, avec un moteur Renault 12Jb de 373 kW (500 ch) et du LATÉ-28.1 avec un moteur Hispano-Suiza 12 Hbr de 500 ch plus puissant. Ce dernier rendait de meilleures performances notamment en vitesse ascensionnelle et horizontale, d’où son utilisation pour le survol des Andes.

une page d’histoire
deux figures en détails
Ses débuts

Revenons plus d’un siècle en arrière…Nous sommes en 1917, Pierre Georges LATÉCOÈRE (PGL), né en 1883, est diplômé de l’École Centrale des Arts et Manufactures de Paris. Il gère des usines familiales de constructions de wagons de chemin de fer, d’obus de canons…
En France, pour soutenir nos troupes de soldats au sol lors de la Première Guerre mondiale, les aéronefs vont jouer un rôle déterminant pour effectuer des missions d’observation, de reconnaissance, de chasse et de bombardement.
Pierre Georges Latécoère obtient du gouvernement français un contrat de sous-traitance pour la fabrication de 1 000 avions de reconnaissance Salmson 2A2. Il s’agit d’un monomoteur de 230 cv, bi-plan, bi-places en tandem.
Le projet audacieux
En septembre 1918, PGL voyant la fin de la guerre arriver, soumet au sous-secrétaire d’État à l’aéronautique le plan ambitieux suivant pour utiliser en temps de paix les avions et les compétences des pilotes et personnels au sol :
« Créer une ligne aérienne régulière et commerciale pour le transport du courrier et des personnes entre la France et l’Argentine » !
Malgré les réticences du gouvernement, le 11 novembre 1918, PGL dépose les statuts d’une entreprise pour la construction et exploitation d’avions afin de relier Toulouse et Santiago du Chili.
Le projet est invraisemblable pour l’époque car les moteurs des avions sont peu fiables, ont peu d’autonomie en carburant. Les transmissions entre avions, stations radio et de navigation sont pratiquement inexistantes. Il va falloir survoler des terres et des mers inhospitalières et affronter des défis à la fois géographiques, techniques, politiques et humains !

Création des infrastructures
En 1918, PGL fait l’acquisition de terrains en friches dans l’Est de Toulouse, quartier de Montaudran en bordure de la voie ferrée Bordeaux/Narbonne. En 5 mois, Pierre Georges Latécoère va créer les ateliers de construction et abris des avions ainsi que les services administratifs et commerciaux nécessaires à l’exploitation de la Ligne.
Le 25 décembre 1918 au matin, malgré de mauvaises conditions météorologiques et les regards inquiets de quelques officiers aviateurs de la Première Guerre mondiale (Pierre Beauté, Henri Lemaître et Jean-Baptiste Morraglia), Pierre Georges Latécoère répond :
« On écrit tous les jours, l’avion postal n’aura de sens que s’il décolle tous les jours. »
Et… peu avant onze heures, l’avion piloté par René Cornemont se pose après 2 h 30 de vol, à Can Tunis – l’hippodrome exigu de Barcelone.
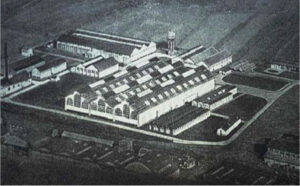

Premiers défis et essais
Janvier 1919 : Ayant obtenu des autorités espagnoles l’autorisation de survol et la création des aéroplaces de Barcelone, Alicante et Malaga pour le ravitaillement en carburant des avions, les relèves d’équipages et le transbordement du courrier postal, Pierre Georges Latécoère se rend au Maroc pour obtenir les mêmes autorisations pour la création des aéroplaces de Tanger – Rabat – Casablanca – Agadir – Cap Juby – et Villa Cisneros.
Des études sont entreprises parallèlement dans les usines de Montaudran pour produire des avions adaptés au projet de Pierre Georges Latécoère – relier la France à l’Amérique du sud, sous la houlette d’Émile Dewoitine puis de Marcel Moine.
Les premiers vols héroïques
Le 03 mars 1919, deux Salmson 2A2 décollent de Montaudran à destination du Maroc, le premier avec Henri Lemaître (pilote) et Beppo de Massimi (passager), le second avec Paul Junquet (pilote) et Pierre Georges Latécoère (passager). Depuis Barcelone, les équipages télégraphient aux autorités locales d’Alicante pour préparer l’aire d’arrivée de 600 m de long en vue de l’atterrissage des 2 avions.
Méprise, c’est un terrain de 600 m² seulement qui est aménagé ! Il manquera donc 350 m de long pour permettre aux avions d’atterrir. Le Salmson piloté par Henri Lemaître sera sérieusement endommagé et l’avion de Pierre Georges Latécoère ayant raté l’escale de Barcelone, se posera plus au sud sur une plage de Tortosa.
Après cet échec, Pierre Georges Latécoère, accompagné du pilote Henri Lemaître, redécollera de Montaudran le 08 Mars 1919 à bord d’un autre Salmson pour rejoindre Rabat le 09 mars 1919, après 11 h 45 de vol et 5 étapes. Ils seront reçus par le général Lyautey à qui Pierre Georges Latécoère remettra le journal « Le temps » de la veille et il offrira un bouquet de violette à la générale.
Marcel Moine, le père des avions Laté…

S’il est un personnage essentiel dans l’équipe rassemblée autour de Pierre-Georges Latécoère, c’est bien Marcel Moine, élément clé de la construction de la plupart des avions en service sur la Ligne Toulouse-Santiago et tout particulièrement le Laté 28 qui permettra à Jean Mermoz de traverser l’Atlantique Sud.
Né à Orléans le 11 février 1894, Marcel Moine obtient le diplôme d’ingénieur des Arts et Métiers à Angers en 1913. Dispensé pour raison de santé des obligations militaires, il commence sa carrière à la Compagnie des Chemins de fer du Nord. Engagé dans l’entreprise Voisin en 1916, il entre dès lors dans la grande famille de l’industrie aéronautique.
L’entrée chez Latécoère et les débuts d’une grande aventure
Formé aux techniques de construction d’avion, il est recruté par Pierre-Georges Latécoère en mai 1918. Il va l’aider ainsi à monter l’unité d’industrialisation des Salmson dans la nouvelle société aéronautique installée à Toulouse-Montaudran et dont la production est gérée alors par Émile Dewoitine. La signature de l’armistice en novembre 1918 ayant interrompu les productions de guerre, l’entreprise Latécoère se tourne vers les applications civiles.
Dès le début de « La Ligne », Marcel Moine se consacre, avec l’aide d’une remarquable équipe d’ingénieurs et de mécaniciens formés par ses soins, à l’entretien et à la restauration du matériel de guerre racheté à l’État. Cependant, l’aviation commerciale, dont le propre est de voler par tous les temps, exige des avions plus performants et de meilleurs moteurs. Considéré à l’époque comme le meilleur spécialiste de la résistance des matériaux, il devient, à partir de 1920, la tête pensante du bureau d’études Latécoère en qualité d’ingénieur en chef, Émile Dewoitine ayant décidé d’exercer seul ses talents en créant une autre entreprise.
Des innovations technologiques majeures
Ainsi, après de nombreux essais en 1919, naissent le Laté 2, monomoteur, entoilé à structure en bois, puis le Laté 3, également entoilé, mais à structure en métal. En 1920, apparaissent le Laté 6, avion militaire de conception métallique, et le Laté 10, avion civil à structure en bois. En 1927, sortent les appareils Latécoère 25 construits en soixante exemplaires pour les lignes aériennes de l’Amérique du Sud. Équipés d’un moteur 450 cv Renault ou 650 cv Hispano, ils permettent d’ores et déjà le franchissement régulier, avec un minimum d’incidents de vol, de distances considérables dépassant 4000 kilomètres.
Viennent ensuite le Laté 26 à moteur Renault, qui peut atteindre Dakar sans escale depuis Toulouse, puis la série des Latécoère 28 dont le Laté 28-3 équipé de flotteurs et d’un moteur 650 cv Hispano. Ce dernier permettra à l’équipage, composé de Jean Mermoz (pilote), Jean Dabry (navigateur) et Léopold Gimié (radio), de franchir l’Atlantique Sud (3000 km) d’un seul coup d’aile les 12 et 13 mai 1930 en 21 heures et 24 minutes. Le Laté 28 sera construit en cinquante-deux exemplaires ; d’une solidité à toute épreuve et d’un rendement élevé, il offrira en outre des conditions de confort remarquables pour l’époque.
L’ère des grands hydravions
En 1930, confirmé comme directeur des études, Marcel Moine s’oriente vers de nouvelles conceptions. Le bois disparaît quasiment pour faire place à des structures en métal, en particulier en duralumin. Sont alors conçus les grands hydravions Laté 298, construits en quatre-vingt-six exemplaires comme torpilleurs rapides pour la Marine nationale, le Laté 300, plus connu sous le nom de « Croix du Sud », d’un poids de 42 tonnes, premier hydravion français transatlantique Nord et à bord duquel Jean Mermoz disparaîtra le 7 décembre 1936 avec tout son équipage (Alexandre Pichodou, copilote, Henri Ezan, navigateur, Edgar Cruveilher, radio et Jean Lavidalie, mécanicien.
Les suivants seront les super-géants comme le Latécoère 521, appelé « Lieutenant de Vaisseau Paris », appareil hexamoteur, d’un poids de 42 tonnes, premier hydravion français transatlantique Nord, mais aussi le Latécoère 523, mis aux mains d’officiers pilotes de la Marine dont celui qui devint l’amiral Hébrard. Ces deux hydravions sillonnèrent l’Atlantique Nord et Sud et battirent de nombreux records. Grâce à cette nouvelle génération d’hydravions, l’objectif tant désiré fut atteint : la liaison aérienne Toulouse-Buenos Aires est réalisée en 1934.
L’expansion industrielle et la guerre : entre défis et résistances
Dès 1937, Pierre-Georges Latécoère crée une autre usine près de Bayonne et Marcel Moine, en tant que directeur général technique de la société, supervise l’ensemble des deux usines. En 1940, après l’association éphémère entre les Sociétés Latécoère et Bréguet, une nouvelle usine est construite dans le quartier de La Roseraie à Toulouse et Marcel Moine en assure la direction. Il poursuit alors la construction des hydravions à long rayon d’action.
L’armistice, en juin 1940, arrête l’exécution des projets militaires et, dès le mois d’août, les travaux continuent sur le Laté 631 « Lionel de Marmier », hydravion hexamoteur d’un poids de 75 tonnes, destiné à la traversée de l’Atlantique Nord et dont les performances sont remarquables. Durant cette période, des études intenses sont menées pour créer des avions long-courriers d’un poids de 150 à 200 tonnes. Pendant l’Occupation, Marcel Moine parvient, avec courage et obstination, à ne pas répondre aux ordres des Allemands et réussit à préserver son Laté 631 n°2, caché en pièces détachées dans des fermes de la région toulousaine.
De l’héritage à l’innovation
Pierre-Georges Latécoère disparaît en 1943 et Marcel Moine assume, à partir de ce moment-là, la pleine responsabilité de l’entreprise, avec l’entière confiance de l’héritier, Pierre-Jean Latécoère. Fonction qu’il assurera avec clairvoyance et talent jusqu’au jour de sa retraite, en 1975. Il sera confronté à la formidable mutation technologique liée à l’informatisation des procédés d’études. La Société Latécoère s’orientera vers l’industrie des matériels spécifiques, en particulier des missiles. En développant ce secteur d’activité, elle crée dès 1960 un domaine de compétences innovant : l’électronique des asservissements et du guidage dont le devenir sera considérable.
En 57 ans de vie professionnelle, Marcel Moine, calme et discret, d’une totale fidélité à Pierre-Georges Latécoère qu’il admirait tant, a mené sa mission avec brio et rigueur. L’un de ses grands mérites est aussi d’avoir réuni autour de lui des ingénieurs et des mécaniciens de haut niveau qui, à la demande de Didier Daurat, partirent sur tous les points chauds de la Ligne France-Amérique du Sud pour y accomplir des miracles de remise en état ou fonder des ateliers permanents d’entretien à des milliers de kilomètres de Toulouse : des hommes qui allèrent jusqu’au bout de leur devoir, jusqu’au bout de leur savoir, jusqu’au bout de leur vie. Marcel Moine fut, indiscutablement, un pilier indispensable des entreprises Latécoère, Pionnier de l’aéronautique française au plein sens du terme. Toute sa vie active fut consacrée à fournir aux pilotes, civils et militaires, l’outil qui leur permet de vaincre, chaque fois un peu plus, l’espace et le temps.
Marcel Moine s’envolera après eux le 2 juillet 1985.
Sources :
Amicale des Pionniers des Lignes Aériennes Latécoère-Aéropostale
« Cent ans d’aviation » (Yves Marc, Éditions Privat)
« Escale » (Martine Laporte)
« Éloge de Monsieur Marcel Moine » prononcé par Jean Laroche lors de la séance du 12 mars 1986 à l’Académie des Sciences de Toulouse.